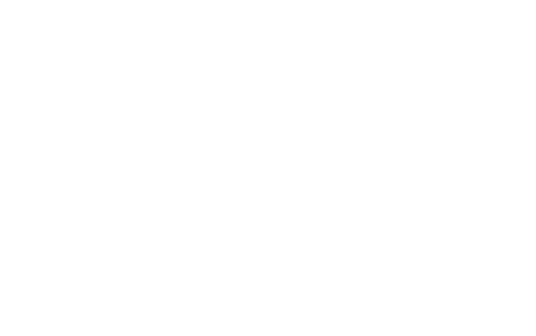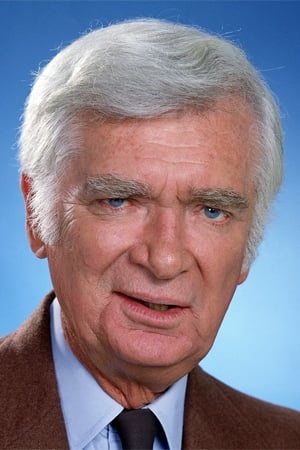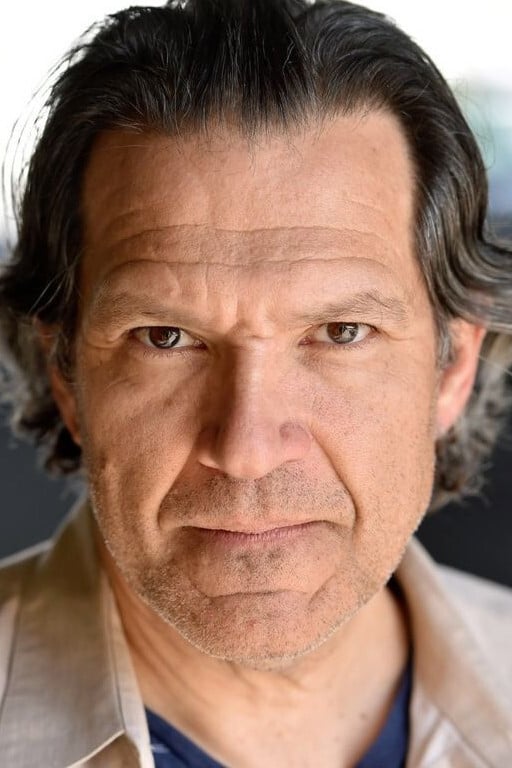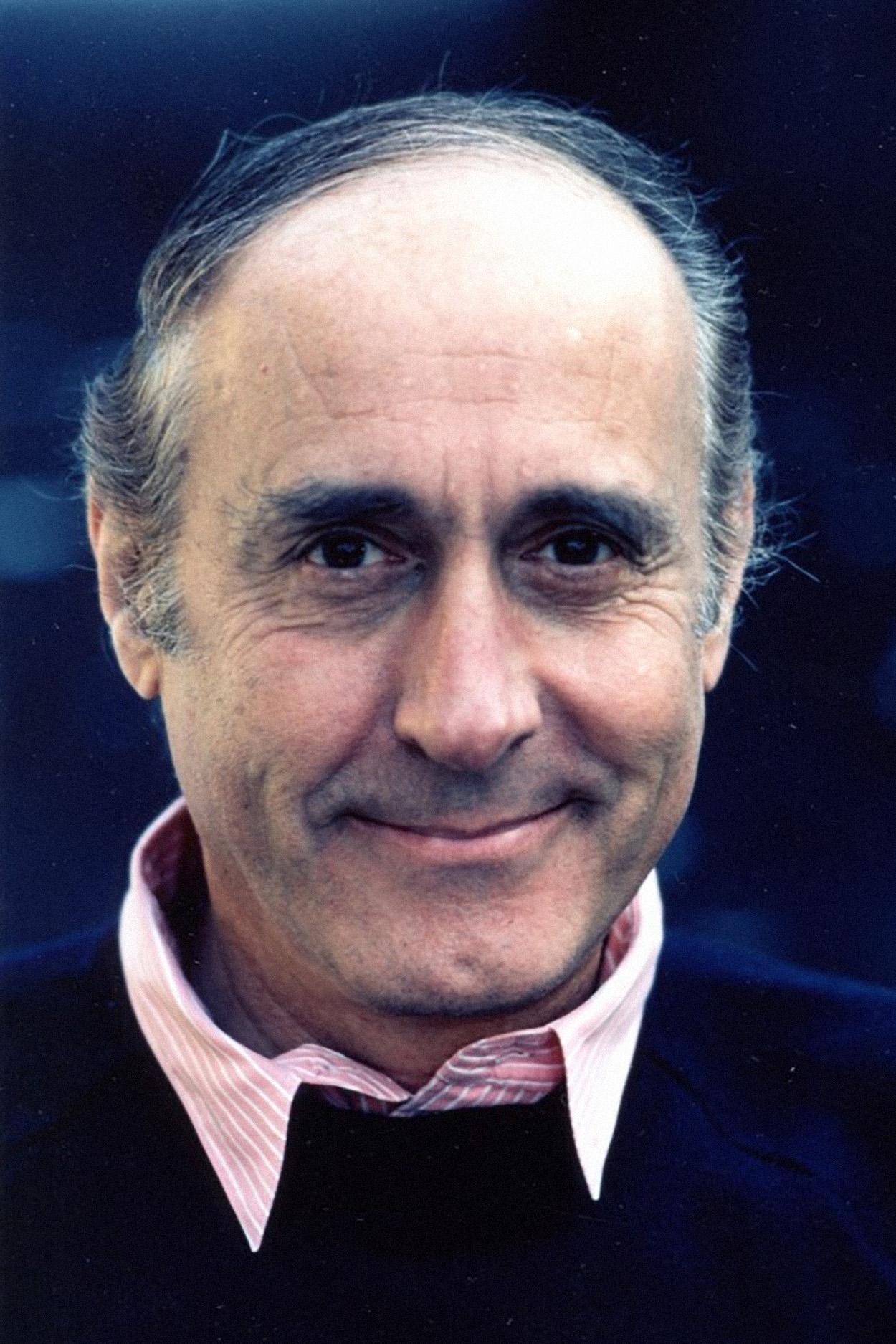Holly (Audrey Hepburn) vit seule dans un appartement new-yorkais dans lequel elle entrepose sa valise et le chat qu’elle a recueilli et auquel elle n’a pas donné de nom. Midinette débarquée de sa cambrousse, elle est attirée par le luxe, le calme et la volupté qui se dégagent d’un magasin chic qui lui semble le paradis sur terre : le Tiffany’s. Ce lieu respirant l’ordre et la beauté est la cristallisation symbolique du milieu qu’elle aimerait intégrer. C’est donc l’une des premières choses qu’elle évoque lorsqu’elle rencontre Paul Varjak, le voisin dont elle ne tarde pas à découvrir qu’il vit dans la même situation de dépendance financière qu’elle. En se donnant les airs d’une jeune fille de bonne famille bonne à marier, elle espère séduire l’une des plus grosses fortunes du pays, afin d’être définitivement à l’abri du besoin. Mais les airs ne suffisent pas, et les riches ne s’y trompent pas quand il s’agit d’épouser une femme issue du même rang social qu’eux.
Sous son apparente légèreté, Diamants sur canapé se révèle un conte cruel sur le poids du déterminisme social. Dans l’espoir de dissimuler son identité roturière, Lula Mae Barnes s’est choisi un pseudonyme rutilant : « Holly Golightly », jeune plante grimpant vers la lumière. Elle réussit à semer le doute chez les « rats » qu’elle fréquente pour leur argent, mais sa candeur la trahit et l’attendrissement qu’elle suscite chez eux est celui que l’on ressent pour plus faible que soi. Le blues la saisit chaque fois qu’elle réalise qu’elle a changé de décor sans fondamentalement changer de statut. Elle ne fuit plus dans la bruyère pour quelques œufs volés, mais par la fenêtre pour quelques dollars escroqués. Même les mariages qu’elle envisage sont déterminés par la nécessité économique et s’apparentent donc à de la prostitution. Pire, le fait qu’elle finisse par y échapper n’est qu’un happy end fort relatif. En effet, sous l’illusion romantique de son « mariage d’amour » transparaît l’implacable force sociologique inclinant les individus à élire des alter ego sociaux et à conclure des alliances homogames. Le discours final de Paul a d’ailleurs tous les accents d’un éloge de la résignation : « Tu as peur de te dire C’est ça, la vie. Mais où que tu coures, tu tombes toujours sur toi-même. » Alors « Madame-je-ne-sais-qui » s’apprête à accepter sa condition en formant une famille avec son gigolo de fiancé et son chat de gouttière.
F.L.