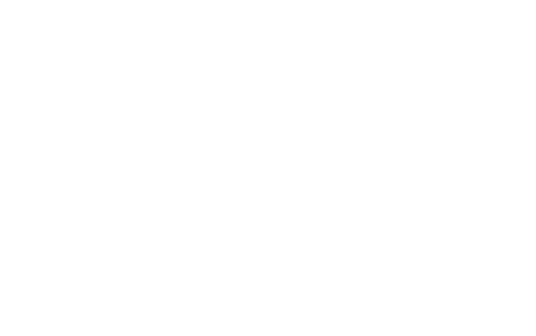Le film de la semaine est La Forme de l’eau.
Plaçant son film dans les États-Unis des années 60, Guillermo del Toro livre l’une de ses œuvres les plus abouties depuis Le Labyrinthe de Pan
et L’Échine du diable.
Favori aux oscars, auréolé du Lion d’Or à Venise, ce film original mêle comédie romantique, conte gothique et film de monstre à la Jack Arnold et son Étrange Créature du Lac Noir.
La Forme de l’eau démontre une fois encore l’étendue du talent du réalisateur mexicain. Un film bouleversant.

La critique :
La résistance de la singularité face aux forces de l’uniformisation est l’un des fils rouges de l’œuvre de Guillermo del Toro. Il n’y déroge pas avec ce nouveau cru, qui nous conte l’histoire d’amour unissant une femme de ménage muette, Elisa, (Sally Hawkins) et un humanoïde amphibie que s’arrachent les puissances américaines et soviétiques en pleine guerre froide. Pour mettre en couleurs le cheminement de l’exclusion à la reconnaissance de ces deux marginaux, le réalisateur mexicain choisit très symboliquement comme dominante la couleur que les comédiens ont longtemps tenu à distance des plateaux de théâtre, et les cinéastes des affiches de films, par superstition puis par convention. Ainsi, à défaut d’avoir « la forme de l’eau », sa fantaisie en a néanmoins le ton : le vert aqueux est omniprésent, mis en valeur par la photographie de Dan Lautsen, léchée à faire pâlir de jalousie Darius Khondji, le brillant chef op de Minuit à Paris, The lost city of Z ou encore inoubliablement du Fabuleux destin d’Amélie Poulain. L’esthétique chromatique n’est d’ailleurs pas la seule à faire penser à l’univers de Jean-Pierre Jeunet. Dans une Baltimore d’après-guerre hyper stylisée, del Toro déroule en effet son intrigue à la confluence du satirique et du fantastique, et parsème son film des cocasseries les plus diverses, n’hésitant pas à recourir à toute la palette des formes d’humour, de la plus prétendument noble à la plus triviale. Là où certains formalistes maniaques signent des œuvres d’une magnificence à couper le souffle, mais d’une pauvreté émotionnelle presque proportionnellement suffocante (Denis Villeneuve, au hasard), del Toro tire lui aussi au cordeau ses décors et ses cadres, mais désamorce tout esprit de sérieux en y logeant systématiquement un détail insolite ou un objet vintage, clin d’œil aux nostalgiques de tous poils. L’environnement de son héroïne est une caverne d’Ali Baba (sise sur un cinéma, s’il-vous-plaît), et elle-même respire le romantisme suranné. Là où dans le monde d’Amélie Poulain la principale affaire était de voir sans être vu, dans celui d’Elisa il s’agit de communiquer sans être entendu. Quelle thématique plus « parlante » pour un amoureux du pur langage visuel ? Extraits de films, personnage de peintre rendu obsolète par l’essor de la photographie… Guillermo del Toro utilise de nombreuses mises en abyme pour évoquer sa nostalgie de l’âge d’or du cinéma, une époque où l’émotion prévalait encore.
F.L.
La bande-annonce :